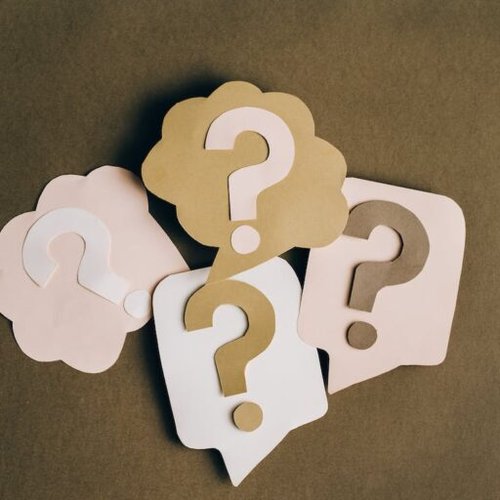Jamila LAHMAR EYTHRIB
Proche aidante et Doctorante sur le sujet du soutien organisationnel des salariés-aidants
Qu’aimerais-tu que les collaborateurs perçoivent ou intègrent concernant la proche aidance ?
La première chose que tout collaborateur doit comprendre, c’est que les aidants articulent deux activités. Ce ne sont pas des personnes moins performantes, ni des personnes feignantes qui cherchent à s’absenter. C’est simplement qu’elles doivent concilier deux rôles, être sur deux fronts en même temps.
Le deuxième point, c’est l’importance de la compréhension et du non-jugement.
Et enfin, le troisième point, c’est de les accompagner dans cette conciliation entre aidance et emploi, pour que tout le monde y gagne.
Que recherchent les aidants dans le soutien apporté par l’entreprise, les proches et les collègues ?
La première chose que les aidants, d’après ce que j’ai entendu, attendent de l’entreprise, c’est qu’elle leur permette d’articuler vie d’aidant et emploi. Parce que bien souvent, l’entreprise leur propose plutôt de sortir de l’emploi. Et ce n’est pas du tout ce que veulent les aidants. Ils ne veulent pas se retrouver uniquement dans le rôle d’aidant, ni sacrifier systématiquement leur vie d’aidant pour le travail. Donc la première chose, c’est vraiment cette histoire de conciliation entre aidance et emploi. Cela passe par de la flexibilité et par la confiance accordée à l’aidant pour qu’il puisse assurer ses deux rôles.
Au niveau du manager, je pense que c’est assez similaire : il doit lui aussi faire confiance. Le travail, de toute façon, sera réalisé. Il faut laisser à l’aidant un peu de liberté dans la façon de s’organiser. C’est là que la notion de flexibilité prend tout son sens.
Concernant les collègues, ce qui est essentiel, c’est la compréhension et le non-jugement. Bien sûr, il faut que la situation ait été expliquée. L’aidant doit aussi prendre ses responsabilités, car il ne peut pas tout reporter sur ses collègues. Mais ces derniers peuvent éventuellement le remplacer ponctuellement, lui apporter du soutien, et surtout ne pas le juger. Encore une fois, il faut faire confiance à l’aidant : il n’est pas là pour profiter du système. D’ailleurs, on constate souvent que les dispositifs mis à leur disposition ne sont même pas activés.
En quoi la présence d’un aidant constitue-t-elle une richesse pour son équipe ?
Au niveau des atouts des salariés aidants pour les collaborateurs, je dirais que la première chose – et c’est souvent ce qu’on me dit – c’est qu’on est aussi aidant en entreprise. C’est très agréable pour un collaborateur d’avoir un collègue bienveillant, quelqu’un qui apporte naturellement de l’aide.
La deuxième chose, c’est qu’un aidant, comme il dispose de peu de temps, développe des compétences en efficacité, en organisation et en stratégie. Il est constamment en train de mettre en place des solutions, d’anticiper, de voir les choses avant les autres. Et ça, c’est plutôt agréable pour l’équipe, parce que cela lui donne un appui supplémentaire. En plus du soutien humain dont je parlais au départ, c’est aussi un vrai renfort.
Enfin, il y a un troisième élément qu’il ne faut pas négliger : un aidant reste une personne vulnérable. Et la vulnérabilité n’a rien de négatif. Au contraire, c’est une forme de transparence. Il n’y a pas de conflits cachés, pas de non-dits, en tout cas la plupart du temps. Et cela permet aux collaborateurs de se confier plus facilement à cette personne, qui est généralement ouverte d’esprit et très compréhensive.
En quoi la transparence et la communication autour de son statut d’aidant sont-elles bénéfiques ?
Bien souvent, les aidants vont parler de leur situation d’aidance. Il existe bien sûr une minorité qui n’en parlent pas, par tabou ou parce qu’ils n’ont pas envie de déranger. Mais dans la plupart des cas, même quand ils veulent le cacher, cela finit par se voir. C’est comme quelqu’un en réunion : on remarque vite qu’il n’est pas totalement présent.
Je me souviens que, quand j’ai changé d’établissement, je m’étais dit : surtout, ne parle pas de ta situation d’aidance. Mais le problème – et c’est ce que j’explique dans ma thèse – c’est que la sphère de l’aidance interfère dans l’emploi, et l’emploi interfère aussi dans l’aidance. On a beau essayer de maîtriser, cette maîtrise est limitée, et à un moment donné, cela devient visible. Mais ce n’est pas forcément négatif.
Si un aidant ne se déclare pas, c’est sans doute parce qu’il ne sent pas qu’il a l’espace ou la sécurité nécessaires pour le faire. En revanche, il peut parfois trouver dans l’entreprise un collaborateur bienveillant qui lui permettra de décharger un peu cette charge mentale. Parce que quand on garde tout pour soi, cela ressort malgré tout : dans la santé, dans le comportement, dans l’attitude. Et paradoxalement, cela peut créer de la suspicion ou des jugements négatifs.
Alors que si la personne se déclare, ne serait-ce que pour expliquer pourquoi elle part plus tôt ou arrive plus tard, le collectif comprend mieux et il n’y a pas de suspicion.
Quelles sont les compétences développées par les aidants ?
La première chose, bien sûr, ce sont les actes de la vie quotidienne. On accompagne son enfant ou son parent dans les besoins physiologiques, de sécurité et aussi les besoins sociaux. Si on reprend la pyramide de Maslow : manger, se laver, communiquer, maintenir des relations… C’est ce que j’appelle les compétences de confort.
Ensuite, il y a tout le suivi médical et thérapeutique : l’accompagnement aux hospitalisations, aux rendez-vous, aux soins, etc. Cela représente un grand nombre de tâches.
On pourrait dire que gérer tout cela, c’est comme gérer une PME familiale, avec ses articulations et ses multiples acteurs.
Vient ensuite un autre bloc : les compétences de soins infirmiers et techniques. Je les distingue des soins de confort parce qu’il s’agit de soins plus invasifs, curatifs. Par exemple, pour les enfants handicapés, cela peut concerner des équipements comme le fauteuil roulant, ou des soins plus poussés comme une gastrostomie, une stomie, etc. Ce sont donc des compétences très spécifiques, très techniques.
Un quatrième élément, que je trouve essentiel et qui n’est jamais mis en avant dans les référentiels de compétences, c’est ce que j’appelle le management des aidances. Cela comprend la recherche, le recrutement, la négociation avec les différents intervenants auprès de la personne aidée – qu’il s’agisse d’une personne âgée ou handicapée. Cela inclut les thérapeutes, les médecins, mais aussi l’école ou la crèche pour un enfant. Cela suppose de la gestion administrative, financière, juridique… bref, toute une coordination.
Un autre volet, souvent réduit à tort à une seule dimension, c’est l’intelligence émotionnelle. Elle se joue sur deux plans : vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. L’aidant doit apprendre à gérer ses propres émotions, ses hauts et ses bas, cet ascenseur émotionnel permanent. Mais il doit aussi gérer les émotions de l’aidé et de l’entourage : absorber des émotions négatives, les transformer en positif, faire preuve de résilience, d’empathie, d’ouverture. C’est presque un rôle de magicien.
Ensuite, il y a la délégation et le répit. L’aidant ne peut pas tout faire, il est obligé de déléguer, un peu comme un chef de projet ou un chef d’orchestre. Et il a aussi besoin de moments de pause pour tenir dans la durée. Cela peut être le fait qu’un membre de la famille prenne le relais le temps d’un week-end ou d’une soirée. Mais il ne s’agit pas seulement de repos : c’est aussi du ressourcement, des moments où l’on retrouve une bulle personnelle ou professionnelle. Moi, par exemple, mon ressourcement, c’est ma thèse. Quand j’y travaille, je suis dans ma bulle, et cela m’aide à avancer.
Enfin, un dernier point important, surtout dans l’aidance parentale : la division des tâches au sein de la famille. Que ce soit entre parents ou entre frères et sœurs, il faut un partage du soin. Et cela aussi, c’est une compétence en soi.
Bref, même si je ne les ai peut-être pas cités dans l’ordre, on peut dire qu’il y a cinq grands blocs de compétences développés par les aidants.
De quelle manière ces compétences peuvent-elles être mises à profit dans l’entreprise ?
Au niveau de la transposition des compétences dans l’emploi, on distingue trois grandes catégories :
- le travail instrumental, qui concerne le soin et l’organisation de ce soin, avec toute la partie administrative et sécurisation ;
- le travail interactionnel, qui porte sur la gestion des émotions et le quotidien avec la famille ;
- et enfin le travail d’articulation, qui consiste à concilier et coordonner les différents acteurs, avec toute la communication que cela suppose.
La première piste, ce serait d’en parler dans les entretiens annuels, notamment les entretiens de carrière, afin de valoriser les compétences acquises dans l’aidance.
On pourrait aussi envisager de les inscrire dans des référentiels métiers.
Aujourd’hui, le problème, c’est que ce sont encore trop souvent les aidants eux-mêmes qui doivent faire la démarche : auto-évaluer leurs compétences et les déclarer. Je pense que l’entreprise a aussi un rôle à jouer : aller à la rencontre de ses aidants, détecter les compétences qu’ils développent. Cela permettrait de repérer certains talents. Et je pèse mes mots en parlant de talents.
Quels conseils donneriez-vous à un référent / ambassadeur aidant ?
D’abord, il faut resituer leur rôle. Leur mission, c’est d’être à l’écoute des aidants, de comprendre les réalités vécues par ces salariés, de faciliter la reconnaissance et la visibilité de l’aidance dans l’entreprise. Ils ont aussi un rôle collectif de sensibilisation. Enfin, ils doivent pouvoir remonter les situations d’aidance critiques auprès des RH ou des managers, afin qu’un accompagnement adapté puisse se mettre en place.
Comment les approcher ? Bien souvent, le référent lui-même est un aidant. S’il partage sa propre expérience, cela permet à un aidant non déclaré de s’identifier, et cela peut ouvrir le dialogue. Parler de son propre cas peut donc être une bonne porte d’entrée.
Une fois ce premier échange établi, il est important d’expliquer à l’aidant qu’il dispose de droits et de dispositifs qu’il peut activer. Cela suppose parfois de révéler sa situation, mais pas toujours : certains accompagnements peuvent aussi passer par un travailleur social extérieur, par exemple.
En résumé, à travers la sensibilisation, le référent aidant peut aider certains collaborateurs à prendre conscience de leur rôle d’aidant – car beaucoup n’en ont même pas conscience – et leur montrer les leviers qu’ils peuvent actionner pour mieux concilier aidance et emploi.
Je pense qu’il ne faut pas aller directement vers l’aidant, mais plutôt l’attirer à soi. Comme en marketing, c’est la stratégie “push and pull”. Bien sûr, ici il ne s’agit pas d’un produit mais d’une personne humaine, donc l’approche est particulière.
Concrètement, il s’agit d’organiser des événements ou des actions dans l’entreprise qui vont naturellement attirer les salariés concernés : journées de sensibilisation, conférences, ateliers… Même si le référent aidant n’est pas lui-même aidant, ces initiatives permettent de créer un espace de dialogue et d’ouvrir la parole.
Si un salarié souhaite ensuite échanger davantage, un entretien peut être organisé. Le rôle du référent aidant n’est pas de mettre en place un accompagnement spécifique, mais plutôt d’orienter vers les personnes compétentes pour le faire.
Quels types d’événements peuvent être organisés pour attirer les aidants, les sensibiliser et les encourager à parler de leur statut ?
La plupart des événements de sensibilisation organisés en entreprise prennent la forme de témoignages d’aidants. Des personnes comme moi viennent raconter leur vie d’aidant, leur parcours de résilience, la manière dont elles ont réussi à tenir et à se relever. C’est le premier format, celui des conférences.
Le deuxième format, ce sont les ateliers. Ils peuvent aborder différents sujets : la santé des aidants, les compétences développées, les stratégies pour concilier aidance et emploi, ou encore des aspects plus techniques, comme les gestes ergonomiques à adopter pour les transferts d’une personne aidée.
Ces événements peuvent être organisés en petits groupes ou en grands groupes, selon les besoins. Une autre option intéressante est la création de communautés de pairs : par exemple, un groupe intranet où les aidants peuvent échanger entre eux. Ce n’est pas toujours généralisable, mais cela peut constituer une solution pérenne pour l’organisation.